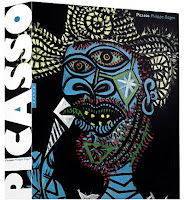 Les multiples expositions consacrées en cette rentrée à Pablo Picasso à Paris sont l’occasion de revenir sur la vie et l’œuvre de cet artiste central du 20ème siècle. C’est ce que nous propose Philippe Dagen dans une très belle monographie consacrée au peintre. Extraits de sa vie d’artiste.
Les multiples expositions consacrées en cette rentrée à Pablo Picasso à Paris sont l’occasion de revenir sur la vie et l’œuvre de cet artiste central du 20ème siècle. C’est ce que nous propose Philippe Dagen dans une très belle monographie consacrée au peintre. Extraits de sa vie d’artiste. Philippe Dagen, dans une monographie à la fois biographique et réflexive, cherche à répondre à un certain nombre de questions que soulève l'exceptionnel artiste Picasso. Il y envisage Picasso dans son époque au-delà des amitiés et des rivalités strictement artistiques du milieu parisien et français, confronté à la modernité du monde.
Un peu avant la Première Guerre Mondiale, face à la modernité scientifique et industrielle, le primitivisme peut être pensé comme la négation résolue du moderne ; le cubisme, à l'inverse comme son acceptation et une façon radicale d'en tirer les conséquences plastiques. Dans une deuxième période, jusqu'au début des années 30, l’artiste, en donnant à chaque sujet sa forme visuelle la plus juste, assuré de ses moyens et de sa logique, de sa position et de sa gloire, est « maître du monde ». Dans un troisième temps est sous le signe des monstres, quand la maîtrise maintenue pendant une quinzaine d'années éclate sous la pression d'événements publics et privés sous le signe du désordre et du drame. Picasso se précipite alors dans l'expérimentation. Enfin, dans la dernière période, le peintre pousse ses extrémités. Dans un monde occidental à nouveau prospère, Picasso rappelle que l'Histoire est vouée à finir par des désastres.
Dans sa famille, tout converge vers l'éducation artistique de l'adolescent, du père qui apprend et surveille à la mère et aux sœurs qui font office de modèle. L'éducation artistique initiale de Picasso s'accomplit à Málaga, la Corogne et Barcelone selon les affections de son père dans les écoles des beaux-arts, et finit à Madrid. L'élève est d'une habileté hors du commun mais il connaît ses limites. Picasso accumule les exercices de style, il copie les maîtres. Jusqu'en 1899, il semble n'avoir d'autre but que le perfectionnement technique et l'adoption des formules et des sujets conventionnels. A ce moment, Madrid est loin de l'émulation artistique de Paris, de Vienne (Klimt), de Munich, de Berlin (Corinth).
Picasso va comprendre que cette première éducation ne le prépare qu'à une carrière sans éclat dans son pays. Commencera alors, à partir de 1899, l'éducation moderne, quand il s'installe à Barcelone. Picasso s'instruit alors par lui-même et en compagnie d'autres très jeunes artistes. Mais dans la limite des connaissances accessibles à Barcelone avant qu'un premier voyage à Paris, en 1900, ne permette une mise à jour plus complète. Picasso fréquente le café Els Quatre Gats, il y exécute des portraits.
C'est une méthode : il étudie et assimile les solutions picturales néo et post impressionnistes (il reprend de façon quasi littérale le style de Degas mais aussi celui de Toulouse-Lautrec), tous les artistes de cette époque (Matisse, Derain, Van Dongen) ont recours à ce procédé. Picasso veut posséder ces références picturales (Van Gogh aussi, Fantin-Latour pour l'impressionnisme, Cézanne). C'est bien plus qu'une imprégnation de différents styles mais une exploration systématique des différentes solutions picturales modernes. Il dispose alors d'autant d'œuvres et de témoins que nécessaire pour amplifier son expérience. Il s'agit de vérifier comment ça se fait et si ça marche. Cela suppose d'abandonner pour un temps le souci d'une expression personnelle singulière, avec l'espoir que celle-ci naîtra de la pratique et de la confrontation des différents styles de la modernité parisienne. C'est, en fait, une véritable stratégie de création : il s'agit de connaître l'environnement contemporain, de mesurer les forces en présence avant de mener campagne.

El loco / El Foll, dessin, 1904
L'obsession du malheur s'empare de l'œuvre. Et Picasso se dégage ainsi de ses contemporains car nul ne peint ainsi à Paris à ce moment-là. Cela surprend les critiques parisiens qui ne peuvent rapprocher Picasso d'aucuns mouvements. A 21 ans, il ne cherche pas à se rapprocher d'un groupe mais prend le risque de priver ceux qui prennent connaissance de ses travaux de tout repère. C'est aux artistes, aux collectionneurs de se situer par rapport à lui. Le naturalisme des toiles de Picasso est moins présent chez les autres peintres que dans les livres des romanciers (Zola, Huysmans…). Chez Monet, Renoir, Pissarro, Gauguin, le thème de la pauvreté est tout simplement absent. Mais, en traitant de la pauvreté, c’est aussi l’aveu de la propre situation du peintre qui ne vend ses peintures qu’à bas prix. Des éléments caractérisent non un anarchisme d'action mais un ensemble de convictions, la certitude que la société bourgeoise et capitaliste n'est pas « habitable ».
Mais au même moment, de quoi et de qui parle dans la critique d'art parisienne curieuse de nouveautés ? On ne parle pas de Picasso, non par oubli mais parce que le peintre refuse de présenter ses œuvres aux Indépendants ou au Salon d'Automne. Dans son art, en 1905, Picasso paraît très peu préoccupé par les sujets et les références qui obsèdent ses contemporains, il est indifférent au néo-impressionnisme comme à Cézanne.

Les Demoiselles d'Avignon, peinture à l'huile, 1907
Pourtant, jusqu'à la fin de l'été 1907, Picasso tire les conséquences de ce qui s'est produit au cours du travail sur les Demoiselles : la plastique du schématisme géométrique et les stries. Les hachures colorées et la géométrie envahissent simultanément les études de nus. Par des voies différentes, les œuvres de Cézanne et de Picasso en sont venues à faire de la géométrie volumétrique un élément décisif de leur peinture. Plus que des procédés picturaux, Picasso a retenu de Cézanne que celui-ci s'est dégagé de la représentation réelle pour concevoir ses œuvres : traiter les formes naturelles par le cylindre et le cube appartient à l'exercice d'une liberté et d'une autorité plus grandes.
Le cubisme ou le processus de l'inconnu
Le mode opératoire, qu'on appelle à partir de 1909 le cubisme (Picasso a toujours réfuté qu'il puisse y avoir un art définitivement nommé « cubisme ») procède par expérience sur le papier et la toile avec des modifications constantes d'un état à l'autre de la formulation plastique : « A mon avis, chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte, c'est trouver (…) Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, et non ce qu'on avait l'intention de faire. » La figure du peintre se rapproche plus alors du savant ou de l'ingénieur que celle du visionnaire. La peinture de Picasso, en 1910-1911, confine peut-être à l'abstraction (comme l'absence de tout indice qui engendre la représentation ou du moins la désignation d'un objet du monde réel).
INVENTER DES CODES NOUVEAUX
Dans Souvenir du Havre peinte en 1912 où l’on trouve de nombreux éléments scripturaux et picturaux, Picasso s'éloigne alors de la phase expérimentale précédente. L'introduction des lettres et des mots comme mode de direct de désignation des objets est une manière de réintroduire ces objets dans l'œuvre. Picasso explore et étend les ressources des lettrages (journal, étiquettes, affiches). Au regardeur, il n'est plus demandé de simplement reconnaître en se fondant sur son expérience quotidienne des objets mais d'identifier les différentes composantes d'une analyse et de les associer. Introduire des lettres permet aussi de se saisir d'un moyen devenu commun (l'affiche), prendre acte des modifications du paysage urbain, conjuguer modernité de la société et modernité de l'art. C'est aussi l'inscription dans une société de plus en plus industrielle. C'est le monde du capitalisme qui prend forme. Les écrivains français (Zola, Flaubert, Huysmans…) ont écrit cette histoire mais leurs contemporains peintres ont préféré l'impressionnisme. Le travail artistique de Picasso arrache les objets à la production industrielle.

Souvenir du Havre, 1912
TENIR TOUS LES STYLES DANS SA MAIN
La situation de Picasso, en 1920 comme en 1914 et comme bien plus tard, a ceci de remarquable qu'elle intéresse des publics absolument étrangers les uns aux autres : les quotidiens, la grande presse, les marchands, les collectionneurs privés et les conservateurs (à l'exception des français jusqu'en 1945), les jeunes artistes. C’est une première pour la figure de l'artiste au 20ème siècle, à l'âge médiatique.
Le nouveau monde
En 1913, Le Sacre du Printemps rend célèbres Cocteau, les Ballets russes, Stravinsky et Diaghilev… Ce milieu a peu en commun avec celui de Picasso. Mais Cocteau obtient que Diaghilev vienne rencontrer Picasso. Si Picasso accepte de participer au projet, ce n'est pas pour se créer une position dominante qu'il a déjà mais peut-être pour renouveler le dispositif social et médiatique qui l'environnait jusqu'en 1914 et dont les protagonistes lui font désormais défaut (Braque, Derain, Apollinaire sont partis à la guerre). Puis la femme avec qui il partageait sa vie, Eva, meurt en 1915, l'effondrement est complet. La représentation scandaleuse de Parade, le 18 mai 1917 marque le succès de ce nouveau réseau artistique et amical. C'est une métamorphose sociale : les séditieux et incompris d'avant 1914 sont en passe de devenir les maîtres du jeu artistique et intellectuel.
Picasso est célèbre et riche, il a une belle femme (la danseuse Olga Khokhlova) et de belles relations. Est-il mieux compris pour autant ? Il continue à utiliser simultanément différents modes graphiques et chromatiques. La réduction des détails physionomiques peut aller jusqu'au profil anguleux (Joueur de guitare, 1916).
.jpg)
Joueur de guitare, 1918
Logique et extension du « sur-réalisme »
Ce que la critique et la presse retiennent, c'est que Picasso aurait lâché le cubisme et serait revenu à une figuration enfin à nouveau accessible à tous parce qu'enfin imitative : celle de ses portraits. Il est vite tenu que le cubisme n'aura été qu'une phase nécessaire d'ascèse au terme de laquelle l'art français peut enfin revenir à ses vertus ancestrales : l'ordre, la clarté, l'harmonie. Philippe Dagen explique que cette théorie du « retour à l'ordre » en ce qui concerne Picasso joint la méconnaissance au contresens. Ses relations aux maîtres sont bien plus libres et audacieuses, délivrées de tout souci de fidélité et d'orthodoxie. Comme auparavant, il s'approprie, il assimile, il métamorphose. Picasso conçoit selon ce principe unique : la justesse en déployant la diversité de ses procédés.
LAISSER SURGIR LES MONSTRES
En 1921, Picasso a 40 ans et nul mieux que lui n'incarne le grand artiste au plus haut de la notoriété et de la fortune. C'est le succès, la gloire et la belle vie. Ceux qui s'obstinent à honorer en lui le fondateur du cubisme l'agacent, il refuse toute notion d'école et de doctrine en art. Il faut réaliser à quel point la position de Picasso est exceptionnelle, aucun de ces contemporains ne sauraient y prétendre. Dans le passé, quand un artiste était ainsi reconnu, c'était le fait du prince (Michel-Ange, Titien, Rubens). En 1924, c'est la reconnaissance par l'argent et la popularisation par la presse qui seules peuvent métamorphoser un vivant en une star. Mais pour quelle idée puisque telle est la nécessité de Picasso ? Picasso ne craindra pas de prendre des risques.
Dans « Surréalisme et la peinture », publié en 1928 par la N.R.F., André Breton (1896-1966), poète et théoricien du surréalisme, précise la position du mouvement à l'égard de l'expression plastique. Il y explique le cubisme non en des termes uniquement formels mais l'identifie comme le moment où la servitude de l'imitation a été rompue et comme celui où Picasso a commencé à ne se fier qu'à son « esprit » : « Le surréalisme, s'il tient à s'assigner une ligne morale de conduite, n'a qu'à en passer par où Picasso en a passé et en passera encore. » Ce qui importe, c'est la marge de liberté qui sépare l'artiste de l'imitation et l'expression de la « vie propre » de l'esprit.
« Je voudrais arriver à ce qu'on ne voie jamais comment mon tableau a été fait. Qu'est-ce que cela peut- faire ? Ce que je souhaite, c'est que de mon tableau se dégage uniquement l'émotion. »
L'art picassien, à partir du milieu des années 20, se fait de plus en plus autobiographique, de plus en plus intime. L'homogénéité tient à l'omniprésence du motif féminin. Leur prolifération va de pair avec une variété de solutions plastiques. Le Baiser reprend le schéma du couple s'étreignant que Picasso a traité à ses débuts : les surfaces ont des contours courbes, parfois sinueux. La charge érotique se donne libre cours.

Le Baiser, 1925
Le surgissement d'un mode d'expression nouveau est indissociable d'une nouvelle idée. Picasso donne ainsi des formes reconnaissables, impossibles à confondre entre elles, à des émotions, des forces… à des principes qui sont ceux que la psychanalyse freudienne nomme Eros et Thanatos. C'est ainsi que le groupe de la revue Documents comprend l'art de Picasso : donner naissance à des figures tout à la fois éloignées de toute ressemblance humaine et néanmoins naturelles et douées de vie, de la vie des forces psychiques et symboliques. Picasso est l'inventeur de figures mythiques nouvelles pour un monde qui se croit rationnel et raisonnable et dont il sait que ce n'est qu'une apparence de la civilisation moderne sur une humanité ni plus ni moins archaïque dans ses passions. La fonction de Picasso, artistique, intellectuelle, morale et politique, est de leur « donner forme ». Telle est la fonction de l'art.
« Picasso », Philippe Dagen, Editions Hazan, 140€









 Paris
Paris


 Nature morte au violon ; hommage à Bach, 1952
Nature morte au violon ; hommage à Bach, 1952 




